L'Étudiant Libre
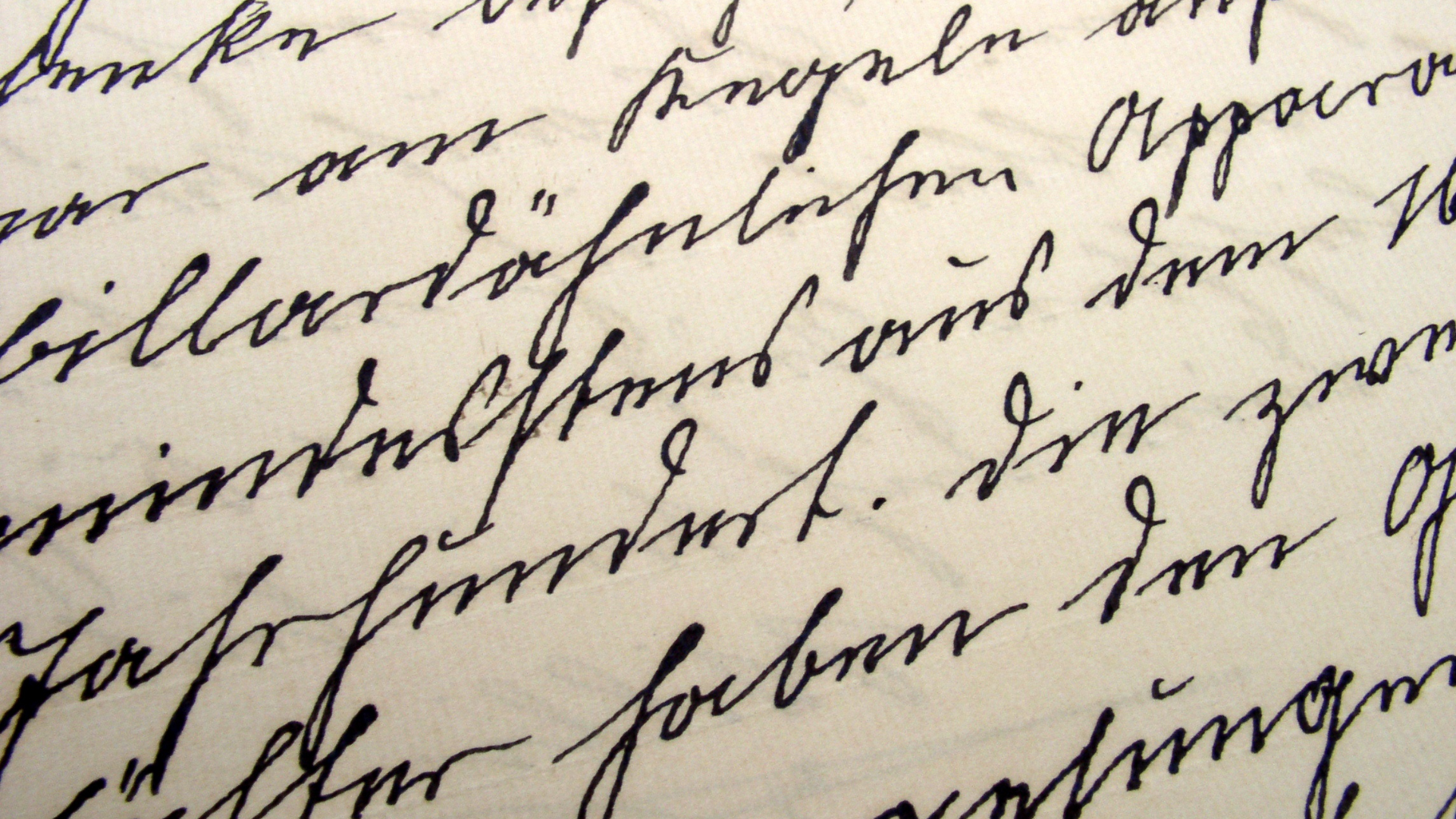
Du haut de son perchoir de la rue des Abbesses, Gilles songeait. Son regard le transportait d’un arrondissement à l’autre plus rapidement qu’aucun moyen de transport jamais inventé jusqu’à ce jour. Ce siècle était à moitié vécu et l’existence humaine l’avait rempli jusque là d’une agitation si futile qu’elle ne saurait l’honorer du mérite d’y emplir l’autre moitié.
Né en 2000, Gilles vieillissait avec son siècle. Cloitré entre les murs décharnés de son studio, il comblait ses journées de longues séances d’observation. La rue des Abbesses, qu’il avait connue populaire et garnie, n’était plus qu’aujourd’hui l’anxieux corridor offrant aux touristes curieux de bien jolies flâneries de la place de Clichy au Sacré-Cœur. Et Gilles regrettait la splendeur de sa rue comme on peut regretter celle de sa patrie. Il faut dire qu’il y avait écoulé plus de la moitié de son existence, et c’est le téléviseur qui lui fit considérer ce fait d’arme d’un œil tout à fait ahuri. On fêtait les trente ans de la guerre sanitaire et les commentateurs, dont le nombre n’avait cessé d’augmenter en même temps que celui des évènements du monde réel s’amenuisait, ne pouvaient s’empêcher de congratuler les choix du gouvernement et de sa majorité. Cette guerre là n’en finissait pas, alors que les efforts déployés jusqu’ici n’avaient pourtant pas cessé de s’affermir. Gilles considérait ces trente dernières années et cette pénible lutte, semblant en découvrir la face. Les évolutions des moyens déployés avaient été lentes et sinueuses, faites d’allers-retours permanents, si bien qu’il était impossible d’en constater les effets pendant le processus. Les tournants que l’Histoire emprunte ne sont pas faits de virages radicaux mais simplement de légères déviations qui ne laissent constater leur aboutissement à la conscience humaine qu’une fois celui-ci dépassé depuis bien longtemps. Devant les images d’archives du premier confinement, l’âme de Gilles rétrogradait jusqu’au souvenir, tentait d’assimiler trois décennies d’Histoire, sa jeunesse écoulée, mais l’habitude prenait toujours le pas sur tout : il n’émanait de ces images qu’une vague indignation devant les autorisations excessives que le gouvernement d’antan avait accordé aux Français des années 2020. En trente années de vacillement, les gouvernements successifs avaient finalement accouché d’un modèle de société à l’épreuve de ses problématiques : on vivait chez soi et cela toute l’année, sans exceptions.
Les rues de Paris n’étaient désormais plus que les voies fonctionnelles de livreurs à vélo, camionnettes de grandes enseignes et touristes qui poulopaient d’un monument à l’autre, profitant du vide laissé par le Parisien assigné à résidence. Ce dernier se résignait, satisfait, à jeter périodiquement du haut de sa balustrade de longs regards en biais qui tombaient sur ces tristes défilés. Le tourisme et le luxe, bras armés de l’économie française, avaient été épargnés par ces mesures sanitaires, et ainsi pouvait-on constater l’empire de l’opulent touriste et de ses non moins riches marchands sur les rues parisiennes, à travers le défilement continuel de tristes cohortes asiatiques parées de grands et sobres sacs arborés de logos évocateurs pour tant d’étrangers du mode de vie français. Quelques grands cafés parisiens avaient aussi pu garder leurs portes ouvertes afin de permettre à ces étrangers de passage, exténués, de se pencher sur une limonade avant de rentrer à leur hôtel. Mais les Parisiens ne tiquaient pas, spectateurs de ces troupeaux de touristes qui se soumettaient complaisamment à la cadence de leur guide entre Bastille et Concorde. Les rues raisonnaient sous leurs pas et quand leurs regards croisaient celui de l’indigène, ce dernier semblait émerger d’une effarante stupeur, puis, aussitôt, se tapissait en son antre. En somme, il ne restait plus grand-chose à faire. Gilles bénéficiait depuis quinze ans, comme tous les Français n’exerçant pas d’activités dans le tourisme ou le luxe, d’un revenu mensuel plus que suffisant ainsi que de l’assurance d’une connexion Internet fiable, droits conditionnés au respect de ces nouvelles mesures. On vieillissait penaud, sans à-coups ni soubresauts, dans ce Paris plus calme que jamais.
Deux mois plus tôt, par le biais d’un email reçu de la part d’une vieille connaissance de Gilles revenue vers lui pour l’occasion, il s’était rapproché d’un groupe occulte dévoué à la libération totale de Paris. Sa décision fut prise très rapidement. Contre l’espace exigu de son studio, le vide effarant des artères parisiennes, les allers et venues continuelles de livreurs dépressifs, les regards pitoyables des amas de promeneurs étrangers, sa détermination n’avait pas vacillé : il entrait en action. Sa mission était simple : s’assurer de la présence, auprès de quelques monuments, des explosifs placés le matin même par le groupe activiste. Paris, ce soir, ne serait plus. Et aurait-on pu élire meilleure date que ce 15 mars 2050 pour en finir avec cette folie ?
Gilles se redressa devant son téléviseur qui laissait échapper les élucubrations d’un énième expert dont la seule prolifération dans les médias avait autorisé l’idéologie nouvelle à poursuivre sa marche. Il allait sortir… Une dizaine d’années avaient fui depuis la dernière fois que sa carcasse avait traversé la porte cochère de son immeuble, et il ressentait déjà en descendant les escaliers le frémissement qui naissait à cette pensée. Il déposa un pied ferme sur l’asphalte et déjà son esprit semblait vivifié par les risques qu’il encourait et les frissons que l’action longtemps méditée donnent aux hommes faits de réflexions. Les forces de police étaient rares, mais les sanctions encourues affligeaient chacun de ses gestes d’une solennité rigoureuse. Bien plus que la perte de son revenu, c’était l’exclusion sociale qui électrisait l’action qu’il s’apprêtait à commettre. Le jour perdait en lumière et les rues se vidaient, une myriade de lucarnes brillantes jetaient d’étranges lueurs sur les pavés que les pas de notre héros frappaient, déterminés.
Gilles, en quelques pas, regagna l’aisance qu’une décennie de sédentarité lui avait confisquée. Les premiers mètres parcourus furent irréels. L’air de ce début de soirée emplissait Montmartre d’une légère brume opaque qui semblait provoquer le trottinement des derniers touristes flânant aux alentours. Émergeant comme d’un de ces rêves qu’on ne souhaite pas quitter, Gilles s’engouffra dans la rue Lepic d’une démarche que la vision de ces rues fantomatiques avait fait redoubler de conviction. Il descendait vers le Moulin Rouge, la mémoire comme cinglée par le souffle exalté des réminiscences qui jaillissaient à la vue des enseignes tapissant la rue déserte. Dans un Paris qui s’assoupissait, Gilles tressaillait au moindre bruit, effrayé à l’idée que l’excursion fut interrompue par l’irruption des forces de l’ordre ; Mais ce furent les vapeurs de sa cigarette, objet d’une époque révolue qu’il portait alors à ses lèvres, qui le lancèrent toutes voiles dehors sur des flots de souvenirs depuis longtemps estompés mais qui, en une seconde, charrièrent de nouveau les pensées de notre protagoniste.
Gilles revoyait, dans une clarté qui l’étonna, les foules endimanchées se pressant contre les étals, les commerçants exténués jouant des coudes pour servir leurs clients, les fruits colorés qui passaient de mains en mains, le délicieux fumet des poulets rôtis qui remontait la rue et enveloppait la Place Anne-Marie Carrière, et les vieux habitués des comptoirs, ouverts sur la rue, dont les regards dardaient sur ce lumineux spectacle. Ce déluge en suspens refluait en son âme. Mais sa mère formait dans ce kaléidoscope enivrant une tâche persistante. Brune, aux cheveux noirs et aux yeux verts, sa mère, sous les traits d’un caractère rigide, était dévouée et affectueuse. Il n’avait connu ces matinées de la rue Lepic que la main dans la sienne et le regard pointé vers son visage, que la résignation à une vie laborieuse avait empli de candeur et de sagesse. D’un coup d’œil, elle obtenait toute la confiance et le respect de n’importe lequel de ses interlocuteurs. En grandissant, Gilles en tira un optimisme dont il eut du mal à se détacher même après sa mort. Vingt-sept années les séparaient désormais, et dix autres l’éloignaient aujourd’hui de ces flâneries dominicales. Une indicible affliction submergeait Gilles alors qu’il débouchait sur le boulevard de Clichy, dont le silence contrastait avec le fourmillement du passé encore perçu par les oreilles de Gilles. Là, sur les trottoirs, de farouches silhouettes s’empressaient vers Dieu sait où, ne brisant le silence monastique du boulevard que par des bruits de pas disparates qui lui donnaient un caractère sacré. Le temps d’un instant, ce mutisme lui fit reconsidérer sa mission. « Le néant que l’annihilation de Paris suppléera à celui qui me fait face vaut-il mieux ? » C’était la pensée qui l’occupait alors qu’il franchissait l’imposante porte du Parc Monceau. Il se rendait à la place de l’Étoile, convaincu que l’ample végétation du parc du dix-septième arrondissement serait plus propice à la discrétion que sa déambulation nécessitait.
Le mépris de toute âme humaine redoubla en lui. Il réalisa enfin que la France était, en grande partie, constituée de lâches débonnaires, vite découragés, emplis de haine d’eux-mêmes et suivant le troupeau. Assurément, ils étaient nés pour l’abattoir, et n’avaient donc que ce qu’ils méritaient.
Isidore Ducasse
Très vite, les pensées de Gilles se délièrent de ces questionnements, tournées désormais vers une éventuelle présence humaine au sein de ces allées. Mais, à son plus grand plaisir et comme il l’attendait, les longs sentiers, ainsi que les spacieux espaces verts qu’ils bordent, demeuraient immaculés. Le soleil s’était éteint, la brume du soir se dissipait. L’atmosphère permettait maintenant aux regards attentifs et dotés d’une âme sensible aux charmes de la nature d’apprécier la délicieuse rupture que ces paysages fuyants causaient dans la jungle urbaine de Paris. Gilles déambulait le long d’un sinueux couloir, l’âme éloignée un temps de sa mission par l’agencement harmonieux sur lequel portaient ses yeux et les sèves ardentes dont, comme par pudeur excessive, les érables et les platanes se débarrassaient une fois les
parterres vidés de toute agitation diurne. L’œil de l’observateur peinait d’abord, hagard, à accrocher un élément distinct du décor. L’aménagement vous laissait impuissant et, comme une symphonie prodigieuse vous empêche, sans que vous ne puissiez l’expliquer, de polariser votre attention sur les notes d’un unique instrument, il vous soumettait à l’extase intégral. Mais, très vite, Monceau, changé en thébaïde épurée, fit dégringoler Gilles dans les méandres de ses réminiscences. Comment pouvait-il en être autrement ? Notre héros avait trébuché, sans recours possible, d’abord sur le petit pont au style romanesque sous lequel une Seine miniature roulait, puis sur l’arcade, vestige d’une ère qui ne figurait même plus dans les livres d’Histoire, puis sur les nombreuses sculptures blanchâtres rendant hommage à des artistes tous oubliés, mais ce fut la vision de la Naumachie, ce vaste bassin ovale que ceignait une somptueuse colonnade corinthienne en ruine, qui acheva de laisser choir Gilles dans ce gouffre de ressouvenances du temps passé. Aveugle aux regards ahuris que les livreurs de plats lui décochaient à travers l’imposante et lourde grille du parc, l’âme du cinquantenaire plongeait dans la contemplation, guidée par des jambes livrées à elles-mêmes, libérées de toute volonté supérieure et qui ne se mouvaient plus que comme des automates à la recherche de stabilité.
Une indicible joie transportait Gilles pour qui la résurgence de ces colonnes offrait le meilleur des véhicules à ce retour en arrière. Il revenait presque quarante en arrière et, comme plus tôt dans la soirée, c’est sa mère qui primait. Elle l’emportait sur ces décors et sur ces sons, si particuliers, que l’âme des nostalgiques fait percevoir à leurs sens. Alors jeune femme, elle guidait Gilles dans les tortueux corridors du jardin et, occasionnellement, cédait à ces supplications en lui offrant une confiserie à l’échoppe qui trônait au sein du parc. Ce lieu auquel le passé l’avait attaché, même vide, demeurait plein. Les bancs délaissés, les arbres tristes, les gazons immaculés, tout relevait la présence de la jeune mère. Pour la première fois depuis sa mort, Gilles tenait en lui une vision de sa mère qui fut tangible, une vision confondante qui résistait à tous les examens, qu’aucune secousse du temps présent n’épuisait. Le boulevard Malesherbes se repeuple de ses cadres trentenaires aux regards odieux qui effraient la naïveté de l’enfant, de familles entières qui se déversent des rues adjacentes, de groupes de jeunes, similaires en tout point, qui usent leurs habits sur les rêches bancs parisiens… Les voitures offrent à la scène un pénible murmure qui, pour Gilles, est recouvert par les pressés cliquetis des talons de sa mère. Si on a le temps, on se traîne le long de l’avenue jusqu’au Cinéma des Cinéastes alors qu’il fait encore jour… Quand on en sort, l’enfant, encore émerveillé par les lumières mouvantes, s’effraie des éclairages qui montent dans la nuit… La mère en sourit, l’enveloppe et le couple silencieux s’enfonce dans la foule comme dans un pays inconnu. D’imposants fragments de foule se disloquent du troupeau… D’autres se forment… Les fumées de tabac s’élèvent anormalement haut… Le bourdonnement des voitures, propre à la journée, laisse sa place à ces bruissements vigoureux ponctués d’éclats de rire et de verres qui s’entrechoquent qui, enfant, vous font naïvement envier la vie d’adulte… Le long du boulevard Barbès, sur le chemin du retour, les théâtres aspirent et rejettent leurs spectateurs avec une telle cadence que ces derniers semblent usés quand on les retrouve sur l’asphalte… Gilles et la jeune mère, que rien ne peut troubler, conservent leur allure à travers ces foules ivres et colorées qui s’agitent comme pour oublier la vacuité…
..« Vous êtes pas bien vous ? Qu’est-ce que vous faites ici à c’t’heure là ? C’est à cause de gens comme vous qu’on en est là ! Ah je te jure l’ancienne génération… »
Un visage hirsute apparut dans la foule, Gilles le distinguait nettement mais, soudain, le tout s’évanouit et ne restait en face de lui qu’un jeune homme aux traits échauffés qui le fixait hargneusement, puis disparut derrière d’épais rideaux. Arrivé par mégarde au beau milieu de l’avenue Vélasquez, il avait causé l’éveil d’une dizaine de riverains étonnés. Gilles, ému, sentait son âme en ébullition. Malgré la stupéfiante limpidité du passé, il sentait poindre en son cœur la lame de l’amertume. Il en voulait au jeune inconnu de l’avoir fait renaître en 2050. Déjà, sa mission refleurissait dans son esprit, mais aussitôt il la reniait. Il n’y avait aucune raison de se démener pour une population enfouie si profondément dans son confort, un peuple fat et suffisant qui voyait dans la figure de ses maitres la promesse d’une délivrance. La mort elle-même ne saurait être à la hauteur du mérite d’une population si naïve. La torpeur dans laquelle elle s’était cloitrée et résignée accrut chez Gilles son dégoût pour l’humanité. Le mépris de toute âme humaine redoubla en lui. Il réalisa enfin que la France était, en grande partie, constituée de lâches débonnaires, vite découragés, emplis de haine d’eux-mêmes et suivant le troupeau. Assurément, ils étaient nés pour l’abattoir et n’avaient donc que ce qu’ils méritaient.
Gilles fit demi-tour sur lui-même, traversa le parc Monceau, remonta les boulevard de Courcelles et de Batignolles, grimpa la rue Caulaincourt, traversa sa lourde porte cochère, gravit l’escalier jusqu’à son perchoir de la rue des Abbesses, puis s’ouvrit les veines d’une incision profonde, tout naturellement, sans artifices ni cérémonie, en économie, sans même briser une éventuelle routine, une habitude qui aurait pu se créer, comme dans une continuité des actes et des paroles qui composent la partition de notre quotidien.

